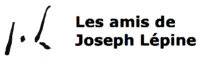Le Catalogue des gravures de Joseph Lépine commence par une eau-forte unique (nGr1) ; nous en connaissons deux autres mais qui ne s’étaient pas prêtées à la prise d’un cliché, au temps des seules photos argentiques.
Ce paysage en plein soleil reprend un motif peint à l’huile, et il est probable qu’il ait été gravé peu avant 1930.
Lépine passe très vite à la gravure sur bois, et la série des travaux qui nous sont parvenus comporte de nombreux tirages d’essai incomplètement impressionnés, et souvent retouchés; il regrave même complètement son Moulin à vent et l’Amont de son Moulin à eau (nGr 25 et 26, puis 28 et 29).
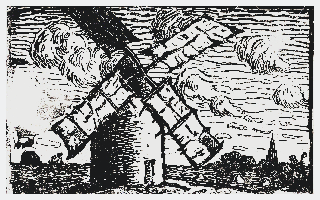

Le peintre bordelais Robert Vallet, constatant que Lépine ponce à la main les plaques de tilleul de ses gravures pour réutiliser ce support, lui fait rencontrer René Muñoz qui pouvait effectuer ce travail en un instant avec ses machines d’ébéniste : lui-même nous l’a rapporté.
Voilà qui oblige à situer dans le milieu des années trente cette activité; il en résulte aussi la certitude que plusieurs gravures (la maison en ruine – nGr23 – et les moulins de Bretagne en particulier) ne sont pas du tout contemporains de ses tableaux correspondants.


Au moment où l’analyse de l’évolution de son œuvre révèle la remarquable élaboration de Lépine sur la matière avec la lumière, j’avais forgé l’hypothèse que son intérêt pour la gravure était parti de là, ce qui ramenait à la même période des années trente.
La confirmation absolue est venue d’un tirage de L’Arbre et le hameau (nGr 15) apparu dans la Vente Briscadieu de janvier 2023, et portant l’indication autographe « été 1931 »;
la Coupe de fruits (nGr 16) est une étude gravée au dos du même bois et on voit combien elle préparait la composition suivante (nGr 17).
On a retrouvé par ailleurs un article de Jac Belaubre de décembre 1932 illustré par la gravure du Chat (nGr 18), avec le superbe dégradé du fond et le fin lignage du sol, un travail certainement réalisé cette année-là.

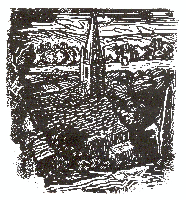
Voilà qui organise tout le déroulement de l’œuvre gravée.
Dans les compositions les plus archaïques comme l’Eglise de Baurech ou la Place d’un village de Corrèze (nGr 2 et 3), les toitures ne dégagent pas leurs lignes de tuiles sur un fond blanc mais un labourage d’entailles blanches sur un fond très noir, et le dégradé du ciel est fait de tracés parallèles progressivement plus fins, mais les nuages blancs sont cernés d’un épais contour;
le Chat présente la même rigidité des limites pour les taches noires de son pelage. Les nuages perdent peu à peu leur naiveté de patate, ils s’ouvrent, s’effilochent, et se mêlent au ciel avec les gravures dans leur maturité, après la charnière de 1931 et 32.
Notre attention se porte alors sur l’introduction par Lépine de son monogramme. Juste gravé en blanc sur le fond noir, en bas à gauche de la Place du village (nGr 3), cette tentative d’introduction ne semble pas satisfaire son auteur et nous n’en connaissons aucune suite.

mais Lépine ne retient pas non plus ce nouveau paraphe dans ses gravures suivantes (nGr 22 à 27). En Amont du moulin, en Corrèze, avec ses deux états successifs, apporte le monogramme inscrit dans un cercle, en même temps que la pleine maturité de sa gravure.
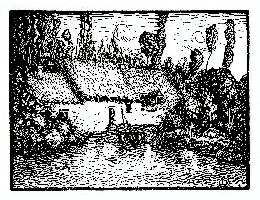
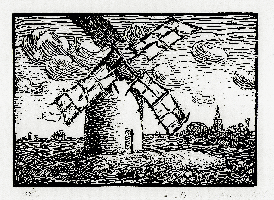
Toutes les œuvres portent désormais les initiales du peintre dans leur petit cercle, mais elles sont surtout remarquables par leur extrême qualité, et il les présente avec ses peintures dans ses dernières expositions, en 1936 et 37 aux expositions de L’OEuvre, en 1939 dans une exposition exclusive de gravures à la Galerie Bonnet à Bordeaux, puis en 1941 au Salon unique de l’ensemble des Sociétés Artistiques de Bordeaux.
Le Moulin en Morbihan et le Vieux moulin en Corrèze (probablement nGr 25 et 29), nettement plus élaborés que les travaux de 1931 et 1932, et exposés au début de 1936, ont donc été gravés en 1934 ou 1935.
Le Paysage de Corrèze exposé début 1937, certainement l’un de ses grands et beaux paysages au tournant d’une rivière ou d’un chemin (nGr 30 à 34), doit dater de 1936.
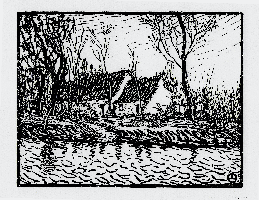
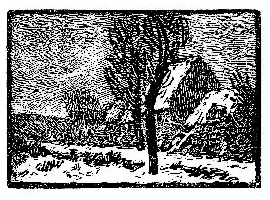
La Neige en Seine-et-Oise (nGr 38), l’une des quatre gravures de neige qui sont la quintessence de cette forme de son art, ne peut que suivre ou accompagner l’aquarelle du même motif réalisée au dos d’un faire-part de mariage du 16 mai 1936: cette Neige fixe ainsi une journée de l’hiver 1937, et elle fait partie (avec probablement celle de nGr 37) des œuvres exposées en février 1941.
Le traitement spécifique de la gravure sur bois est le bord de l’entaille du canif ou de la gouge qui devient limite « tranchée » entre le noir et le blanc; l’Expressionnisme a aimé cette technique contrastée adoptée par Gauguin et Munch, puis les Fauves ou les artistes de la Brücke: une telle pratique est aux antipodes de l’esthétique Impressionniste, avec ses couleurs claires et le flou de sa touche, qui avait investi à l’inverse l’eau-forte et la lithographie.
L’œuvre gravé de Lépine prend ici un caractère paradoxal en introduisant l’atmosphère à travers la technique la moins propice à ce message-là, et elle se place avec ce parti-pris complexe au-delà de l’Impressionnisme.
L’un des moments caractéristiques de cette brillante synthèse est le travail d’En amont du vieux moulin, du fait des deux versions successives retrouvées : le mur ensoleillé devient encore plus lumineux dans la version finale, le ciel s’éclaire aussi avec l’oubli de quelques nuages et quelques arbres, et le reflet de l’eau partage ce supplément d’éclat.
Les « touches » de la toiture abandonnent le tracé parallèle des coups de gouge pour s’organiser en puzzle plus complexe et scintiller de lumière autant que le plan d’eau. L’étrange mosaïque démontre son efficacité, détruit ce qui subsistait des tracés linéaires, efface les limites en mêlant davantage les toitures au feuillage qui les entoure. Il n’y a plus de tracé continu des bords d’un toit ou d’un chemin, et la juxtaposition du noir et du blanc opère de façon inattendue la décomposition progressive des contours.


 )
)Les Neiges constituent le plein aboutissement de ce processus d’éclatement de toutes les limites : les murs et les arbres, les coteaux et les ciels ne sont plus que des valeurs de gris qui se prolongent et s’interpénètrent.
Les ciels des Neiges, véritable virtuosité pour la gravure, offrent de vastes plages de gris où la juxtaposition admirablement fragmentée du noir et du blanc forme un enchevêtrement subtil et modulé des antagonistes. La gravure sur bois n’avait peut-être jamais rendu un tel jeu de sensibilité, elle est un grand moment du talent de Lépine.
Ph. G.
Retrouvez l’intégralité des œuvres connues dans le catalogue des gravures : Gravures sur bois.